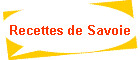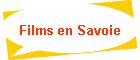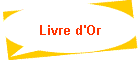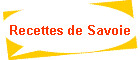
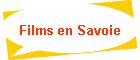

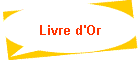
|
|

|
La
marmotte des Alpes appartient à la famille des sciuridés.
Elle mesure entre 48 et 61 cm. Elle est dotée d'immenses incisives et
de petites mains composées de cinq griffes aux pâtes postérieures et
de quatre griffes aux membres antérieurs. Elle peut écarter
considérablement les doigts lui servant à manier et à éplucher sa
nourriture.
Ses pattes et ses oreilles sont courtes, sa queue est à moitié noire.
Son pelage est brun jaunâtre avec la tête plus foncée, elle est dotée
d'une fourrure isolante, changeant de qualité en fonction de la saison
: doublant de volume en hiver et plus fine l'été.
Elle perçoit les couleurs mais sa vue est inférieure à celle de
l'homme. Dotée d'un champ visuel de 300°, supérieur à celui de l'homme
qui n'est que de 160°.

|
|
Son habitat :
La marmotte des Alpes élit domicile de
préférence sur les versants exposés au soleil, sur des terrains où
alternent plaques d'herbe et rocailles, ce qui n'exclue pas leur
implantation en forêt. En Haute-Maurienne, une grande population de
marmottes vivent entre 1.700 et 2.700 m d'altitude.
|
|
Son mode de vie :
La marmotte des Alpes est un mammifère diurne
qui ne sort pas la nuit car elle est dépourvue de vision
crépusculaire. De nature paresseuse, elle passe ses journées à faire
la sieste au soleil, à creuser des galeries, à contempler le paysage,
dressée immobile sur son postérieur en "chandelier" pour monter la
garde ou grignoter quelque racine.
Elles vivent en colonie, composées de plusieurs familles, sur un
territoire de 3.000 à 15.000 m².
Chaque groupe familial comprend un couple reproducteur accompagné de
leurs descendants des deux ou trois dernières années, soit en tout de
5 à 15 individus.
|
|
|
|
Hibernation :
Dès que la température extérieure s'abaisse au
dessous de 12°c, la marmotte se réfugie au plus profond de son
terrier, où elle passera la rude saison dans un état léthargique, la
tête entre les cuisses, dos rond recouvert par sa queue. La période
d'hibernation des marmottes en Haute-Maurienne-Vanoise dure 6 longs
mois, elle s'échelonne de la fin du mois de septembre jusqu'à la fin
mars, début avril où notre marmotte des Alpes pourra sortir à nouveau
son museau. Vous comprenez mieux l'expression
"dormir comme une marmotte".
Elle aura pris soin de se gorger de nourriture afin d'accumuler une
sérieuse couche de graisse sous-cutanée qui servira de réserves et de
protection contre le froid. Les mâles adultes seront les premiers
couchés et les premiers réveillés au printemps, alors que les jeunes
de l'année s'endormiront et se réveilleront les derniers.
Leur estomac et leurs intestins se sont vidés, leur température
interne passe de 38°c à 8°c et peut s'abaisser au voisinage de celle
du terrier, entre 3 et 4°c. On note également une forte régression des
principales glandes endocrines (glandes génitales, hypophyse…). Sa
respiration se fait rare et périodique, la cage thoracique ne s'élève
plus que 2 ou 3 fois à la minute, elle respire moins en un mois
d'hibernation qu'en un jour d'éveil (environ 72 000 fois). De 220
pulsations à la minute, le cœur ralentit ses battements et ne bat plus
qu'à 30 fois à la minute. Cependant le corps se régule
automatiquement, puisque si la température s'abaisse trop, le cœur
accélère le mouvement car le système nerveux continue à transmettre
des informations.
Ce profond sommeil est entrecoupé de réveils plus ou moins
périodiques, plus nombreux en début et en fin d'hibernation qu'au cœur
de l'hiver, qui permettront à la marmotte de s'alimenter.
En léthargie, leur cerveau sécrète des hormones permettant ainsi à
leur organisme d'extraire des tissus de réserves de petites quantités
de substances nutritives. Les dépenses énergétiques demeurent très
faible, par contre les réveils sont consommateurs de réserves
graisseuses et l'animal sortira amaigri de son hibernation. La
marmotte peut arriver à perdre du quart à la moitié de son poids.
|
|
|
|
Sa reproduction :
La saison des amours a lieu à la fin avril
début mai, les accouplements se passent en général dans le secret des
terriers. Une femelle ne peut se reproduire qu'à l'âge de 3 ou 4 ans
et ne porte bas que tous les deux ans afin d'élever et nourrir ses
marmottons tout en accumulant des réserves de graisses suffisantes
pour endurer l'hiver.
La gestation ne dure que 35 jours. C'est à la début juin, sur une
litière bien sèche, après avoir bouché l'entrée principale avec du
foin que les femelles mettront au monde 2 à 5 petits marmottons pesant
à peine 30 g., les yeux clos, entièrement dépourvus de poils.
Seulement 15 jours après leur naissance, les marmottons pointeront
leur nez dehors. Sevrés à l'âge d'un mois et demi, ils passent leur
temps à jouer autour du terrier, s'y réfugiant à la moindre alerte,
pour bien vite remettre le nez dehors, poussé par une curiosité
dévorante.
En période de reproduction, chaque famille entretient des relations
agressives avec les autres membres de la colonie. Chaque couple
s'approprie un domaine vital dont les limites sont marquées par des
sécrétions de glandes situées sur les joues. La dépose répétée de ces
sécrétions sur des roches ou sur la terre laisse souvent la zone
arrière de l'œil des marmottes dépourvue de poils.
Chaque domaine vital de la colonie se compose de deux parties : une
première où se trouve la zone des terriers et la deuxième où se trouve
la nourriture.
|
|
Sa nourriture :
La marmotte des Alpes est gourmande, sa
nourriture est à base de plantes : crocus, trèfles, carlines acaules,
bourgeons, racines, bulbes, graines, fruits ou écorces, mais aussi
vers, larves, insectes comme les sauterelles et criquets. Elle peut
manger jusqu'à 500 g de nourriture par jours et 100 kg pour six mois
d'activité. son poids va doubler du printemps à l'automne ; pour un
homme cela reviendrait à ingurgiter 6 kg de nourriture par jour.
La marmotte n'a pas besoin de torrent, l'eau des plantes et la rosée
lui suffisent amplement. Par contre, elle est très friande de sel.
|
|
|
|
Ses prédateurs :
La marmotte a une durée de vie de 14 à
16 ans, si elle a eu la chance d'échapper à ses prédateurs. Elle
siffle pour prévenir la colonie du danger. Ce signal d'alarme est un
cri strident portant à plusieurs kilomètres. Si le danger est éloigné,
le cri est répété plusieurs fois et repris en cœur par toutes les
marmottes.
Les dangers peuvent être terrestres et aériens :
 | l'aigle royal, prédateur de la
marmotte par excellence l'enlève dans ses serres sans même ralentir
son vol. Il est signalé par un seul cri strident. Immédiatement, ce
cri vide la montagne de ses habitants à l'approche de la grande
ombre mortelle. |
 | ses prédateurs terrestres : le
renard, est accueilli par un concert de sifflements perçants, repris
inlassablement à en perdre haleine, chaque marmotte de la colonie
surveillant les moindres mouvements du renard. (les chiens sont
signalés de la même manière). |
 |
|
Sa protection :
Elle reste aujourd'hui protégée dans les zones
du Parc National de la Vanoise et dans les espaces protégés. Mais en
période de chasse, les chasseurs ne sont autorisés à la chasser que
quelques jours par an. Cependant, son déterrage et son piégeage sont
strictement interdits.
Autrefois chassée pour sa viande, dure mais appréciée en ragoût en
période difficile, sa fourrure d'automne qui était vendue pour la
réalisation de manteaux pour les dames de la ville (heureusement le
manteau de fourrure de marmotte n'est plus la mode aujourd'hui !!).
La graisse de marmotte était employée en friction contre les
rhumatismes, en cuisine, pour cirer les meubles et les chaussures de
montagnes et servait à s'éclairer dans les chalets d'alpage. De nos
jours, sa graisse est utilisée pour fabriquer des emplâtres et des
crèmes.
|
|
Sa réintroduction :
La marmotte des Alpes a été réintroduite dans
le massif central en 1967, dans le Vercors en 1974 et en Chartreuse en
1984. |
Accueil | St Jean de Maurienne | Villargondran | Notre appartement | Centres d'intérêt | Les stations de ski | Galerie photo | Recettes de Savoie | Films en Savoie | Les Marmottes | Livre d'Or
La dernière mise à jour de ce site date du
11/05/05
|